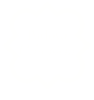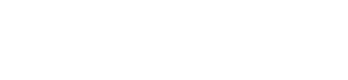1130 est la date du document de San Bellino, évêque de Padoue, dans lequel on trouve la première mention d’une église à Cartura, appelée Santa Maria della Valle. La deuxième citation se trouve dans une dîme papale de 1297, qui révèle qu’elle dépendait de la paroisse de Pernumia.
Pour que Cartura devienne une paroisse autonome, il fallut attendre 1440, date à laquelle il fut décidé de construire une nouvelle église qui pourrait remplacer l’ancienne et décadente structure du XIIe siècle et ainsi pouvoir contenir la population croissante. La deuxième église de Cartura est mentionnée dans une description de 1489 rédigée par l’évêque de Padoue, Pietro Barozzi. D’autres documents datant de 1536 attestent que l’église était de taille moyenne, mais très sombre à l’intérieur et généralement bien conservée. Du même rapport on apprend que le clocher était ancien, contrairement à la structure principale, témoignant ainsi des différentes périodes de construction.
Suite à une nouvelle augmentation de la population en peu de temps, en 1696, le curé de l’époque, Don Girolamo, docteur De-Grandis, décida de construire une nouvelle église. En 1700, en effet, seule la grande nef fut construite. Puis, avec l’arrivée de Don Paolo Maria Trentini, curé de Cartura entre 1767 et 1811, divers travaux d’agrandissement et de restauration furent réalisés, parmi lesquels l’ajout de cinq autels latéraux, le renouvellement de l’orgue, la construction des fresques, la la surélévation des murs et la rénovation du clocher, ce dernier remontant encore à la première structure. En 1811 est également inauguré le nouveau cimetière qui, conformément à l’Edit de Saint Cloud, est placé à 150 mètres de l’église.
D’autres travaux de restauration par les curés ultérieurs pour la conservation et l’entretien ont été réalisés au fil des siècles, aboutissant à la structure visible toujours dédiée à Santa Maria Assunta.
Suite à la construction de la nouvelle église, elle fut également enrichie d’œuvres d’art pour la décorer. L’œuvre la plus ancienne conservée à l’intérieur de l’église remonte à la première moitié du XVIIe siècle et est un petit tableau attribué à Zanetti, de l’école vénitienne des XVIe et XVIIe siècles, représentant la Crucifixion. Cette œuvre a été léguée à l’église de Cartura par le curé De Grandis avec son testament en 1717 et se trouve actuellement dans la sacristie. Dans ce tableau, l’immensité et la désolation du paysage environnant reflètent la solitude vécue par le Christ au moment de son sacrifice, solitude atténuée seulement par la présence des deux chérubins. Datant de 1702 et attribué à l’artiste vénitien Giovanni Battista Cromer, le retable représente Saint Antoine en adoration devant l’Enfant Jésus et la Vierge. L’attitude du corps assumée par le saint est particulièrement importante dans cette œuvre : plutôt qu’une contemplation extatique, il s’agit plutôt d’un « abandon presque douloureux à l’appel de la foi ».
A noter également le retable de la Madonna della Cintura, dans l’abside de l’église. Cette œuvre tire son nom de la confrérie née à Cartura en 1650, très active en termes d’actions de religiosité populaire. Le retable, également œuvre de Cromer, a été réalisé en 1731 et représente la Vierge, représentée pendant l’Assomption, entourée d’anges et en position élevée par rapport aux deux figures de saint Augustin et de sainte Monique. Dans ce tableau, les visages des deux saints apparaissent confiants et confiants, tandis que la Vierge semble révéler l’affliction de devoir quitter la terre, contrairement à l’iconographie classique.
Un véritable trésor se cache dans cette église : la fresque du plafond, peinte en 1793 par Giandomenico Tiepolo, fils du célèbre peintre vénitien Giambattista Tiepolo. La fresque représente l’Assomption de Marie, peinte avec des couleurs vives et une atmosphère de légèreté raréfiée. La Vierge, placée sur une nuée et transportée par des anges, quitte la terre et les apôtres la regardent avec consternation, incapables d’expliquer la signification de l’événement. Le critique d’art Roberto Bassi-Rathgeb, dans une étude de 1965, la compare à la fresque de l’Assomption de l’Oratorio della Purità d’Udine de son père. Giandomenico insère quelques innovations : l’espace entre les deux groupes de personnages est plus large, élément qui crée une rupture entre les deux moments de la scène, symbole des deux réalités différentes et opposées de la sérénité en Dieu après la mort, avec Marie, et de la souffrance. de la vie terrestre, avec les apôtres. Les mêmes apôtres qui présentent des expressions et des physionomies « bizarres et grotesques » de ceux qui choisissent de se désespérer et de se contorsionner, au lieu d’accepter les événements avec sérénité comme la Vierge. Les visages des apôtres ont été comparés aux fresques inquiétantes de la Villa Tiepolo à Zianigo du même peintre, indiquant ainsi la “condamnation de l’auteur à l’égard de ceux qui sont agités par des choses qu’ils ne peuvent pas changer” et transmettant ainsi une leçon pour l’observateur.